CAHIER DE RECHERCHE DE DRM
|
|
|
- Géraldine Marie-Rose Paris
- il y a 10 ans
- Total affichages :
Transcription
1 CAHIER DE RECHERCHE DE DRM N Une analyse de l efficacité des stratégies de labellisation pour les marques des enseignes Fabrice LARCENEUX Chargé de Recherche CNRS DRM - ERMES [email protected] : Valérie RENAUDIN Maître de Conférences - DRM - ERMES [email protected] :
2 Résumé : Il n existe plus une seule sorte de marques de distributeurs (MDD) : les enseignes détiennent aujourd hui de larges portefeuilles de MDD, nécessitant des positionnements clairement différenciés. Et, dans la concurrence avec les marques nationales (MN), elles utilisent de nombreux signes de qualité. Nous interrogeons la pertinence des positionnements voulus par les enseignes d une part et l efficacité des cette stratégie de marquage de la qualité. Une enquête terrain et une expérimentation en sortie de caisse permettent de montrer que les MN sont perçues de qualité équivalente à celle des MDD thématiques, toutes deux surpassant la qualité perçue des MDD classiques. Contrairement à une idée souvent répandue, si l utilisation des labels officiels s avère efficace pour améliorer la qualité perçue des MDD classiques elle ne l est pas pour les MDD thématiques et les MN. De plus, le rapport qualité / prix de ces marques n est jamais impacté. Ces résultats sont discutés du point de vue des enseignes et des Pouvoirs publics. Mots-clés : MDD, Label, biologique, enseignes, distributeurs, positionnement, qualité, prix, rapport qualité / prix Is quality seal of approval really useful to private labels? Summary: Retailers hold portfolios of complex and structured private labels (PL) brands from low cost positioning to premium. In addition, in recent years, the competition between these various brands with national brands invite to use many quality cues with the aim of improving the quality perceived by client. We question the appropriateness and effectiveness of this strategy of marking quality. An experiment shows that national brands are perceived as equivalent in quality to that of premium PL (PL+), both surpassing the perceived quality of classic private labels. The use of quality seals seems much more effective to improve the perceived quality of classic private label compared with PL+ and national brands, for which labels appear irrelevant. Results are discussed. Key-Words: private label, seal of approval, organic label, retailers, quality, price, value for money.
3 Introduction : des MDD en plein essor La part de marché des marques de distributeurs (MDD) connaît une croissance spectaculaire dans la plupart des pays du monde. En France, elle a quasiment doublé entre 1996 et 2009, passant de 20% à 36% des ventes en volume dans la grande distribution alimentaire (Source Xerfi). Cette forte progression témoigne de l intérêt que les MDD suscitent auprès des distributeurs et de l adhésion qu elles recueillent auprès des clients. Accompagnant cet accroissement, un changement qualitatif s est opéré. En quelques décennies, on est passé de marques dites «metoo», pâles copies génériques des marques nationales, à des MDD variées et innovantes, ambassadrices du positionnement des enseignes. Le taux de pénétration des MDD avoisine les 99% : presque tous les ménages en achètent. Elles sont aujourd hui présentes dans quasiment toutes les catégories de produits. L objectif affiché par la plupart des dirigeants d enseignes consiste à vendre une référence sur deux en MDD. Cette volonté de développer l offre de MDD s appuie sur un contexte juridique favorable. La loi de modernisation de l économie (LME) ayant eu pour effet de faire baisser le prix des marques nationales leader et de dégrader les marges des distributeurs sur ces références phare, les distributeurs misent aujourd hui davantage sur les MDD, plus rentables. Dans une visée plus stratégique, les distributeurs font de leurs MDD le fer de lance de leur positionnement marketing : à travers elles, ils expriment leurs valeurs, leurs différences, et leurs engagements auprès de leurs clients. Leur image étant en jeu, les enseignes sont extrêmement attentives à la qualité des produits vendus sous leurs marques. Dans l environnement très concurrentiel de la grande distribution, les enseignes cherchent non seulement à valoriser la qualité des MDD, mais surtout à faire reconnaître l excellence de leur rapport qualité / prix, censé être supérieur à celui des marques nationales (MN). Pour atteindre cet objectif, une des stratégies développées par les enseignes consiste à apposer sur le packaging des MDD divers labels de qualité (label biologique AB, Label Rouge, Max Havelaar etc.). Cette stratégie de labellisation des MDD devient de plus en plus fréquente, non seulement sur les MDD classiques, mais surtout sur les MDD thématiques, en plein développement.
4 Cette recherche a ainsi un double objectif. Il s agit tout d abord, via des entretiens avec des professionnels, d expliciter la stratégie de positionnement des différents types de MDD, entre elles et par rapport aux MN, et de s interroger sur l intérêt de leur labellisation. Puis, la stratégie de positionnement des MDD est analysée par l intermédiaire de deux études : dans un premier temps, des relevés de prix dans la catégorie de saumons fumés sont effectués au sein de cinq enseignes et confrontés au discours général des distributeurs. Dans un second temps, une expérimentation est menée auprès de 270 clients de l enseigne Monoprix afin d explorer leur perception de différentes marques de cette catégorie (M, Monoprix Bio, Monoprix Gourmet et Labeyrie) selon qu elles sont, ou non, labellisés AB et Label Rouge. La structuration des MDD perçue par les clients est mise en regard de la structuration de l offre souhaitée par les enseignes. La pertinence de leur labellisation, tant via le label biologique AB que le Label Rouge est alors discutée. Quel positionnement en termes de rapport qualité / prix des divers types de MDD? Les distributeurs cherchent aujourd hui à détenir de véritables portefeuilles de MDD structurés et optimisés. Chaque MDD est conçue de manière à se différencier du reste de l offre et à créer un capital de marque qui lui est propre. Des entretiens ont été menés auprès de huit experts, managers d enseignes (responsables MDD de grandes enseignes) et spécialistes de la MDD (consultants, représentants d associations). Ceux-ci ont permis d expliciter ce que recouvre aujourd hui la dénomination de MDD afin d enrichir les catégorisations opérées dans la littérature (4). Il en ressort tout d abord que le socle de la promesse commune à toutes les MDD est le suivant : dans chaque enseigne et pour chaque segment du marché, la MDD est conçue pour présenter la meilleure alternative au client en termes de rapport qualité / prix. Cette promesse s appuie sur un avantage concurrentiel structurel : les produits commercialisés sous MDD intègrent des coûts marketing et de commercialisation moindres par rapport aux MN cibles, ce qui leur permet, pour un niveau de qualité donné, de pratiquer des prix inférieurs à ceux des MN. La condition du succès d une MDD réside donc dans le fait que le client perçoit clairement cet avantage.
5 Aujourd hui, les MDD s affichent sur différents segments d offre en termes de hauteur de gamme, et occupent des niches stratégiques sur lesquelles les MN sont peu présentes. On peut identifier trois grands types de MDD. A chacune correspond une promesse spécifique en termes de qualité, de prix et de rapport qualité / prix. 1) Les MDD économiques, qui fondent leur positionnement sur une qualité inférieure à celle des MN pour un prix environ 50% moins élevé. Il s agit par exemple des marques Eco+ de Leclerc, Bien Vu de Système U, ou Carrefour Discount (dernière née plus qualitative que ses concurrentes et qui remporte un vif succès). Elles sont censées concurrencer les premiers prix sans marque et l offre des hard discounters. Elles ont un rapport qualité / prix supérieur à celui des premiers prix sans marque, en général grâce à une qualité supérieure pour un prix comparable. 2) Les MDD classiques ou cœur de gamme, par exemple la marque M de Monoprix ou la marque Repère chez Leclerc. Elles entrent en concurrence avec la MN leader, offrant des produits d une qualité équivalente, vendus 20 à 30% moins cher. Il s agit en principe de l offre présentant le meilleur rapport qualité / prix du marché. Ces marques représentent en 2008, 71% des ventes de MDD (Source Kantar Worldpanel). 3) Les MDD «+» : généralement situées dans le haut de gamme, elles reflètent une démarche opportuniste d occupation de niches. Elle vise directement un segment de clientèle particulier ou mettent l accent sur une dimension particulière du produit supposée être recherchée par certains clients. Dans le premier cas, il s agit de marques thématiques transversales tel Rik et Rok (Auchan) qui offre des produits spécifiquement adaptés aux besoins des enfants sur des catégories de produits très variées (tomates cerises, cahiers d écoliers, brosses à dents, etc.). Dans le second cas, une propriété particulière du produit est valorisée. Dans l alimentaire par exemple, la dimension principale recherchée par les consommateurs concerne le plaisir lié à l expérience de consommation et le goût du produit. Ainsi, des MDD telles que Monoprix Gourmet, Casino Délices ou Mmm! (Auchan) sont clairement des marques premium situées dans le dernier quartile (le plus haut de gamme). Elles revendiquent une qualité supérieure à la MN leader du rayon. En marge de ce positionnement «gourmand», d autres dimensions sont aussi investies par les MDD,
6 dès lors qu elles correspondent à la demande d une certaine partie de la clientèle. Il peut s agir par exemple de produits sans allergènes tels ceux vendus sous la marque Mieux vivre sans gluten (Auchan), de produits du terroir tels que Reflets de France (Carrefour) ou de produits inspirés des préoccupations sociétales tels que Carrefour Solidaire, etc. Deux grandes stratégies prix sont alors mises en œuvre par les MDD+ (9) : - La stratégie dite «premium price» : elle consiste à proposer des MDD premium clairement revendiquées comme de qualité supérieure à la MN leader et vendues volontairement plus cher. Encore timidement appliquée en France (seules les marques Monoprix Gourmet et Casino Délices la pratiquent dans certaines catégories de produits), cette stratégie suppose que la MDD soit capable de justifier l écart de prix avec la MN de référence. - la stratégie dite «premium-lite» : elle consiste à proposer des MDD premium qui, en dépit d une qualité supérieure à la MN, que ce soit sur le plan gustatif ou en raison d attributs de qualité intrinsèque particuliers, conservent un prix légèrement inférieur à celui de la MN leader. Il s agit de la stratégie dominante des distributeurs français. Cette structuration en trois groupes de marques fait écho à la stratégie GBB (Good Better Best) affichée par Tesco et la plupart des distributeurs britanniques ainsi que par les enseignes suisses Migros et Coop. Cette stratégie repose sur le triptyque de MDD suivant : l offre économique Good (Tesco Value), l offre intermédiaire Better (marque standard Tesco) et l offre premium Best (Tesco Finest). Aux côtés de ces 3 MDD structurantes, l enseigne propose des gammes complémentaires, usant d une politique de prix à géométrie variable en fonction des catégories de produits (Tesco Organic, Tesco FreeFrom ). En Suisse et en Grande-Bretagne, les deux pays les plus avancés en termes de MDD (53% de ventes en volume sont réalisées par les MDD en Suisse et 47% en Grande-Bretagne, Source PLMA), une stratégie de premium price très nette est appliquée sur les produits Best et acceptée par les clients. En France, l ensemble des MDD thématiques et premium représente un segment encore faible, même s il a passé le cap des 2% de part de marché en 2008 (Source Kantar Worldpanel). Cependant entre 2008 et 2009, c est sur ce segment que l on a constaté la plus forte croissance du CA (+ 23,3% pour les MDD thématiques contre
7 +8% pour le total des MDD) et du nombre de références (+34,5% contre +8,9% pour le total des MDD). Le développement de ces gammes de produits constitue un enjeu stratégique d image et de rentabilité pour les distributeurs. Néanmoins, les enseignes françaises hésitent souvent à afficher un prix plus élevé que celui de la MN leader. La MDD+ française ne constitue pas en soi, comme dans le modèle GGB, un segment identifié comme celui du très haut de gamme de la MDD. L étude 1 explore ce positionnement. Etude 1 Le positionnement des MDD opéré par les enseignes L objectif de cette première étude consiste à confronter le positionnement souhaité des différents types de MDD, tel qu il ressort du discours des enseignes, à la réalité du positionnement en rayon, traduite en termes d échelles de prix en magasin (encadré 1). Encadré 1 : Le relevé de linéaire Des relevés de linéaires - assortiment, espace alloué et prix - ont été réalisés sur la catégorie des saumons fumés (packs de 4 tranches provenant d Ecosse ou, à défaut, de Norvège). Cette catégorie a été choisie pour trois raisons : les divers types de MDD sont présents, la part de marché de l ensemble des MDD (qui s élève à 58,6% en 2007 d après PLMA) est élevée, et, enfin, les labels AB et Label Rouge y sont largement représentés. Les supermarchés sélectionnés (Casino, Monoprix, Simply Market, Carrefour Market et Super U) sont de surface de vente comparable (environ 1600 m 2 ) et sont situés dans des zones de chalandise relativement similaires. Les relevés sont le reflet d une situation ponctuelle, à une date donnée : ils ne peuvent être considérés comme le reflet de la politique générale des enseignes mais constituent une étude de cas qui fournit des informations utiles sur des stratégies de positionnement mises en œuvre. L analyse des relevés montre que la structure de l assortiment de la catégorie de produits varie selon les enseignes, témoignant de stratégies-volume non homogènes. Ainsi, la part de linéaire des MDD dans l espace occupé par l ensemble
8 des références varie fortement d un magasin à l autre : de 49% du linéaire chez Simply Market à 90% chez Super U. Dans chaque magasin, une marque premier-prix est proposée, que ce soit la MDD économique de l enseigne lorsqu elle en détient une ou un produit sans marque. Le premier-prix est généralement deux fois moins cher que la seconde référence la moins chère de l assortiment pour un nombre de tranches identique. Le segment de l offre économique est donc clairement positionné. On trouve systématiquement la MDD classique, ainsi que des MDD+, en particulier bio et premium. Enfin, la MN leader (Labeyrie) est très présente dans l ensemble des magasins. L assortiment est souvent complété avec une seconde MN plus chère (par exemple Compartiment Fumeur et Robert Delmas chez Simply Market) ou avec une marque challenger moins chère (par exemple Delpierre chez Carrefour Market). Globalement, sur cette catégorie de produits, il n existe que les deux types de labels : AB et Label Rouge. Outre les MDD+ bio, systématiquement labellisées AB, la politique de labellisation des MDD+ premium diffère d une enseigne à l autre. Auchan par exemple n appose aucun label sur sa marque Mmm! En revanche, chez Casino, Carrefour Market et Simply Market, environ un tiers des MDD+ premium est estampillé du Label Rouge, les autres n étant pas labellisés. Parmi les magasins étudiés, le cas de Monoprix est riche d enseignement : il s agit de la seule enseigne qui labellise quasiment toutes les références de saumon fumé (il n y a qu un seul saumon non labellisé hors émincés de saumon et saumons marinés sur les 9 référencés dans le point de vente). Le Label Rouge est présent sur 5 références Monoprix Gourmet et cette enseigne propose 3 références Monoprix Gourmet portant le label AB. Ce qui revient à distinguer au sein des MDD biologiques, deux positionnements distincts : les produits d une qualité standard (commercialisés sous la marque Monoprix Bio) d une part et les produits premium «gourmands» qui justifient d être commercialisés dans la gamme Monoprix Gourmet. Monoprix est la seule enseigne à pratiquer ce distinguo de marques pour un même label. Du fait de cette grande variété de références, l analyse des stratégies de prix pratiquées est particulièrement intéressante (figure 1). On retrouve en haut de gamme une stratégie premium price : le prix de la MDD+ (Monoprix Gourmet) est nettement supérieur à celui de la MN (Labeyrie). La référence la plus chère de l assortiment, la MN premium (Le Borvo), permet d ancrer le prix de la MDD+
9 (Monoprix Gourmet) dans un rapport plus facilement acceptable par le client via un effet de compromis. De manière surprenante, on remarque enfin que la MDD+ labellisée AB (Monoprix Bio) constitue l entrée de gamme du segment qualitatif regroupant les MN et les MDD+. Figure 1 - Relevé de prix pour le lot de 4 tranches de saumon fumé Ecosse ou Norvège - Magasin Monoprix Premier prix PP 3,20 André Ledun MN 6,60 Labeyrie MN 7,55 LeBorvo MN 9,99 4,99 MDD M (Norvège) 6,20 MDD+ Monoprix Bio Label AB 8,95 MDD+ Monoprix gourmet Label Rouge Prix euros Globalement, les autres enseignes pratiquent une stratégie de premium lite, à l opposé des stratégies MDD+ «Best» d inspiration anglo-saxonne. Les références des MDD+ Carrefour Sélection, Mmm!, Casino Délices et Saveur U, qu elles soient labellisées ou non, restent toujours moins chères que la MN leader (Labeyrie). Pour éviter sans doute un prix facial trop élevé des références labellisées, Carrefour Market et Super U jouent sur le format du pack : ils choisissent de ne proposer des références de MDD+ labellisées que sur des packs de deux tranches. Cette étude conforte l idée que l on reste assez loin d une application systématique de la triple segmentation du modèle GBB anglo-saxon : si les premiers prix et les MDD économiques sont bien identifiés, il n existe pas de stratégie claire et partagée sur la signalisation optimale de la qualité pour les MDD, même si l on note globalement une préoccupation autour de l effet prix induit par les labels. Ces positionnements divers mixant MN, MDD+ et MDD classique, avec ou sans labels, peuvent être de nature à brouiller la perception des clients. Le label, une opportunité pour les MDD? La stratégie de labellisation constitue aujourd hui une opportunité d autant plus intéressante qu il existe une forte réglementation limitant la possibilité pour les
10 marques d user de simples allégations évocatrices trompeuses 1 du type «produit naturel», «biologique», «écologique», «bon pour la santé», etc. Qu est-ce qu un label? La notion de label est en réalité ambiguë. Une définition large renvoie à l idée d un signe qui garantit quelque chose aux yeux des consommateurs. Souvent associé à un pictogramme iconique, il peut intégrer diverses allégations, marques et autolabellisations. La définition stricte juridique renvoie la notion de label 2 a une marque collective (Annexe 2). La loi d orientation agricole de 2007 ne précise pas réellement la définition d un label mais structure trois niveaux de valorisation de la qualité des produits : les certifications de conformité, les mentions valorisantes (type produit fermier) et les signes officiels d identification de la qualité et de l origine (articles L du code de la propriété intellectuelle). Parmi eux, le label bio AB et le Label Rouge sont fortement présents en GMS, sur de nombreuses catégories de produits et sont les signes officiels les plus connus des consommateurs français (Annexe 1). Pourquoi un signal de qualité? Les signaux de qualité en général sont utiles dès lors que les individus n ont pas accès à toutes les informations sur les caractéristiques des produits. Ces situations d asymétrie d information entre le fabricant et le consommateur peuvent concerner trois stades dans le cycle de vie du produit : - le premier stade S1 est celui de l avant-vente, de la conception du produit à la logistique permettant sa mise en rayon. Il renvoie à la qualité des ingrédients utilisés, au processus de production, aux termes de l échange (processus de fabrication respectueux, commercialisation équitable, etc.) et au circuit emprunté par le produit (empreinte carbone, etc.) ; - le deuxième stade S2 concerne soit l expérience de consommation, appréhendée au travers des cinq sens (goût, odeur, etc.), soit l utilisation du produit (performance énergétique, etc.) ; - le troisième stade S3 concerne la vie du produit après sa première utilisation, son impact sur l environnement (capacité de recyclage, etc.) ou sur le consommateur (risque pour la santé, etc.). 1 comme le régit la note d'information n de la DGCCRF 2 A noter que le terme label serait réservé au seul «Label Rouge» d après l arrêt du 23/09/2004 rendu par la cour d appel de Versailles : le promoteur de cette marque ayant réalisé des investissements pour construire une réputation distinctive, l utilisation de ce terme dans un autre cadre relèverait de l usurpation.
11 Ces asymétries d information renvoient aux classiques dimensions d expérience et de croyance définies au début des années 1970 par Nelson (1). Pour évaluer les phases amont du cycle de vie du produit (S1), le consommateur peut chercher des informations sur les dimensions de croyance. Les labels (AB, Max Havelaar, etc.) renseignent alors le consommateur mais il ne sera pas en mesure d en vérifier la promesse, même après consommation ou utilisation : impossible de vérifier que les œufs que l on a mangés sont bio ou qu un chocolat est issu du commerce équitable. A contrario, les dimensions de la qualité concernant l expérience de consommation (S2) sont classiquement renseignées via les promesses sur la satisfaction des cinq sens lors de l achat (marque gustative telles que Mmm!, allégation saveur, etc.). Le consommateur est en mesure d évaluer leur véracité au moment de la consommation. Enfin, concernant l après-consommation (S3), il est à nouveau appréhendé à travers des signes dont le consommateur n est pas en mesure d estimer la réalité (logo du recyclage, etc.). Dans l ensemble, divers signes et allégations sur le packaging peuvent alors pallier ces différents défauts d information mais la garantie des pouvoirs publics apportée par les signes officiels semble d autant plus nécessaire qu il s agit d informer sur les dimensions de croyance que le consommateur ne peut pas estimer seul. Pour être utile, le signe de qualité doit être perçu comme crédible et porteur d informations pertinentes au moment de la décision d achat (7). En effet, la stratégie de labellisation est assimilable à une stratégie de «co-branding» qui permet de créer des associations implicites entre le label et la marque support (6,11). L avantage pour la marque est de bénéficier d associations positives, caractéristiques des labels (image écologique, respect de l environnement, etc.). Mais il pose un double problème aux MDD : il s agit d une part, de savoir si le label offre un positionnement qualitatif réellement supérieur, notamment pour les MDD+ et d autre part, d identifier un éventuel risque d une image-prix élevée. Ces deux points sont détaillés ci-après. Si les consommateurs ont souvent du mal à connaître la véritable signification de chaque label, il est établi que celui-ci a d autant moins de probabilité de les influencer qu il bénéficie d une faible notoriété (5). En France, la notoriété apparaît aujourd hui très élevée tant pour le label AB que pour le Label Rouge (Annexe 1). Mais, la
12 plupart des enquêtes proviennent d instituts de sondages évaluant une notoriété spontanée ou assistée, déconnectée du produit ou du contexte d achat. Dès lors, il n est pas surprenant qu un label soit considéré comme la meilleure garantie pour se rassurer sur la qualité d un produit (40%), devant son prix ou sa marque (Ifop, 2010). En réalité, de nombreux éléments contribuent à façonner l image de qualité d un produit (13). Les marques qui bénéficient d un fort capital garantissent de facto un certain niveau de qualité et l effet marginal supplémentaire du label sur la qualité perçue du produit n est pas toujours évident (14). Des recherches ont même montré que les marques constituaient une information parfois plus utile pour les consommateurs que certains labels (3,7). Ainsi, la question de la capacité du label à communiquer une qualité supérieure paraît particulièrement pertinente pour les MDD, dont on peut penser que le capital de marque est moins porteur d image de qualité que celui des MN. Le contexte informationnel en général, la publicité ou l expérience d achat conduisent à établir dans l esprit des consommateurs un lien implicite entre qualité et prix (12). Fondé sur des raccourcis cognitifs, appelés heuristiques de jugement, ce lien est souvent opéré de manière inconsciente. La présence d un label sur une MDD est donc potentiellement de nature à véhiculer une image-prix plus élevée du produit, menaçant ainsi l avantage concurrentiel en termes de rapport qualité / prix perçu. Si la relation entre l image-prix d un produit et sa qualité objective est loin d être évidente (certains chercheurs ont par exemple trouvé une corrélation très faible, r=0,27 (16)), elle apparaît aujourd hui encore justifiée pour les produits labellisés, y compris ceux distribués en grande distribution, du fait notamment du discours sur le renchérissement des matières premières et du processus de production. De fait, dans le cas des produits biologiques, il existerait une prime de prix de 20 à 30 % selon des sources officielles telles que l Agence Bio, différence qui peut monter jusqu à près de 70% dans certaines enseignes (Linéaire, 2009). Cette image-prix n est évidemment pas uniforme et varie en fonction des consommateurs (15), des catégories de produits et des marques support (8). Il reste donc crucial d explorer d une part la structuration réelle des MDD par rapport aux MN et d autre part d interroger la labellisation comme stratégie pertinente en termes de rapport qualité / prix, notamment face à la MN. L étude 2 s y attache.
13 Etude 2 MDD, MDD+, MN, labels, quels positionnements perçus par les clients? Afin d estimer la perception qu ont les clients de la structuration des différentes marques (MDD, MDD+ et MN), ainsi que l effet des labels sur le positionnement de ces marques, une expérimentation en sortie de magasin a été mise en place (encadré 2). La catégorie de produits étudiée est, comme dans l étude 1, celle des saumons fumés (packs de 4 tranches). L enseigne Monoprix a été choisie comme terrain d étude en raison de la variété et de la force de ses MDD thématiques, dont la part de marché est nettement plus élevée que dans les autres enseignes. Encadré 2 : Une expérimentation en sortie de caisse L expérimentation 3*3, manipulant les types de marques supports (MDD : M de Monoprix ; MDD+ = Monoprix Gourmet ; MN = Labeyrie) et les labels (non labellisé ; label AB ; Label Rouge), est menée et décomposée en trois niveaux d analyse. Les packagings des 9 produits testés sont présentés en annexe 3. Le premier niveau d analyse consiste à étudier la perception de la structuration de ces trois marques, le second niveau étudie l effet du label AB sur ces marques, et le troisième, l effet du Label Rouge. Au total, 270 personnes ont été soumises à un packaging spécifique et interrogées en sortie de caisse (ventilation des effectifs en annexe 3). Chaque répondant devait évaluer le packaging présenté, sur une échelle de 1 à 7, en termes de qualité globale perçue, d image-prix (la fourchette du prix psychologique est calculée à partir des deux questions suivantes : «En dessous de quel prix n achèteriez vous pas ce produit?» et «A partir de quel prix considérez vous que ce produit est vendu à un prix excessif?», l image prix résultant de la moyenne de ces deux valeurs). Le rapport qualité / prix a été calculé à partir du niveau de qualité globale perçue et du prix moyen perçu. De plus, les trois niveaux du cycle de vie du produit sont questionnés : l aspect respectueux de l environnement du mode de production (S1), le goût perçu (S2) et le risque perçu pour la santé (S3). Les variables sociodémographiques, la fréquence d achat du type de produits et la fréquence de visite de l enseigne ont été contrôlées.
14 Une MDD+ comparable à la MN Une première analyse des résultats confirme la double structure identifiée dans l étude 1 : il n existe pas de différence significative entre la qualité perçue de la MDD+ et celle de la MN. En revanche, la qualité de la MN et de la MDD+ sont perçues comme significativement supérieures à celle de la MDD classique (cf. figure 2). Figure 2 Perception des trois types de marques 7,00 6,00 5,00 5,87 5,44 4,41 5,03 4,00 3,00 2,00 3,60 3,65 3,27 2,10 2,07 2,01 1,73 2,87 3,63 3,73 2,37 2,50 1,63 1,70 MDD MDD + MN 1,00 0,00 Qualité globale Prix moyen Qualité/prix Goût Elevage respectueux Risque perçu Différence significative (p=0,05) Le positionnement au sein des MDD apparaît correctement hiérarchisé dans l esprit des clients : la MDD+ surpasse en qualité et en prix perçus la MDD classique. En revanche, contrairement à ce qui est souhaité par les enseignes, les clients ne perçoivent pas la supériorité qualitative de la MDD+ sur la MN leader. De surcroît, la MDD classique souffre d un déficit d image par rapport à la MN leader : la qualité est jugée significativement inférieure. En conséquence, le rapport qualité / prix n est pas significativement différent pour la MDD, la MDD+ et la MN : le discours des enseignes sur un meilleur rapport qualité / prix des MDD n est pas perçu comme tel par les clients. Finalement, la structuration des marques s opère via des clés d entrée par deux niveaux de prix : un univers de prix bas (avec quelques premiers prix et la MDD classique) et un univers de prix plus élevés (MDD+ et MN). On observe donc que les clients de l enseigne n ont pas intégré la supériorité du prix de la MDD+ par rapport à celui de la MN dans la catégorie des saumons fumés. La question de la légitimité de la stratégie de premium price poursuivie par l enseigne est donc posée.
15 Une MDD classique labellisée qui monte en gamme La labellisation AB de la MDD classique (M de Monoprix) augmente significativement la qualité perçue du produit. Ce faisant, cette labellisation positionne le produit sur un autre segment de marché, plus qualitatif, avec une image-prix en correspondance, significativement plus élevée. Conséquence de cette stratégie, qualité et prix augmentent de manière proportionnelle, conduisant à une stabilité du rapport qualité / prix perçu. Cette stratégie ne se révèle donc pas particulièrement pertinente sur ce critère. Figure 3 Effet du label AB sur la perception des MDD classiques 6,00 5,00 5,23 4,60 4,60 4,00 3,00 2,00 3,60 3,15 2,10 2,07 2,12 2,87 2,37 2,50 1,57 MDD MDD AB 1,00 0,00 Qualité globale Prix moyen Qualité/prix Goût Elevage respectueux Risque perçu Différence significative (p=0,05) Lorsque le logo AB est apposé sur la MDD classique, cette dernière bénéficie d une amélioration du goût perçu et de la perception d un élevage respectueux de l environnement. Le risque perçu, relativement faible sur la MDD classique reste stable. Une MDD+ et une MN qui ne bénéficient pas de l effet du label AB Pour ce qui concerne la MDD+, de manière surprenante, la labellisation AB a peu d impact (figure 4) : elle n augmente ni la qualité perçue ni le prix perçu et ne fait donc pas varier le rapport qualité / prix perçu. La marque reste dans le même segment de marché. Cet absence d effet peut s expliquer par le fait que la marque thématique (Monoprix Gourmet) est positionnée sur un niveau de qualité tel, que la mise en place d un label (label AB sur Monoprix Bio) se révèle une information peu utile pour le consommateur, tant pour communiquer sur le goût, que sur la notion d élevage respectueux ou sur le risque perçu.
16 Figure 4 Effet du label AB sur la perception des MDD+ 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 5,44 5,17 3,27 3,43 2,01 1,86 4,41 3,79 3,63 4,00 1,63 1,55 MDD+ MDD+ AB 1,00 0,00 Qualité globale Prix moyen Qualité/prix Goût Elevage respectueux Risque perçu Les résultats sont identiques pour la MN (Labeyrie) et corroborent l idée que la labellisation AB apporte peu d informations utiles et différenciantes aux clients (Annexe 4). La qualité globale est déjà perçue particulièrement élevée pour la marque non labellisée. Le label n améliore pas la perception de la qualité globale du produit vendu ni n influence significativement le rapport qualité / prix. Des effets similaires pour le Label Rouge Les mêmes analyses ont été conduites afin d explorer l effet du Label Rouge sur ces trois types de marques. Les résultats sont globalement répliqués (annexe 5) : - la MDD classique bénéficie d un réel avantage en termes de qualité perçue lorsqu elle bénéficie du Label Rouge, mais sans pour autant véhiculer une image de cherté. Cette stratégie ne conduit cependant pas à une amélioration significative du rapport qualité / prix de la MDD disposant du Label Rouge par rapport à la MDD sans label. - Comme pour le label AB, la MDD+ et la MN ne bénéficient pas d une augmentation significative de la qualité perçue. L image prix n étant pas dégradée, on ne note pas d amélioration du rapport qualité / prix. - Cette labellisation de la MDD ne permet pas de concurrencer directement la MN en termes de positionnement de rapport qualité / prix. Finalement, des analyses de régression (tableau 1) menées sur l ensemble de l échantillon montrent que les labels (AB et Label Rouge), une fois contrôlé l effet de la marque, n impactent que légèrement la qualité globale perçue du produit (impact significatif au seuil de 10%). Il existe un net renchérissement de l image prix d un produit labellisé bio dans l esprit du client, mais ce n est pas le cas pour le Label Rouge. Quel qu il soit, le label ne modifie pas le rapport qualité / prix des produits, ni
17 le goût perçu. Le label AB ne comporte aucune promesse liée au goût, ce résultat est donc cohérent. En revanche, les clients ne perçoivent pas la promesse pourtant forte d une qualité gustative supérieure des produits disposant du Label Rouge. La labellisation ne parvient pas non plus à réduire la perception d un risque pour la santé (on peut penser qu en dehors des périodes de crises alimentaires, la sécurité sanitaire des produits, quelle que soit leur marque et la présence ou non de labels, est jugée élevée). En revanche, la labellisation AB et Label Rouge rassure de manière claire le client sur les conditions d élevage des animaux. Il faut remarquer en outre que les clients forment leur jugement global sur la qualité du produit en intégrant les dimensions goût et santé, mais sans prendre en compte l aspect respectueux de l environnement. Le label les rassure sur cette dimension qui reste périphérique pour le client. Tableau 1 Effet du label (une fois contrôlé l effet-marque) qualité prix qualité goût globale moyen / prix Label + + NS NS AB (p=0,055) (p=0,003) Label + NS NS NS Rouge (p=0,051) élevage respectueux + (p=0,000) + (p=0,029) risque santé NS NS Conclusion Cette recherche avait pour objectif d explorer la structuration de l offre MDD par rapport aux MN et l intérêt d adopter une stratégie de labellisation pour véhiculer des informations sur la qualité des produits auprès des clients. Il ressort qu en dehors d un segment «bas prix» bien identifié, il reste encore une grande confusion autour du positionnement des différentes marques. Le cas étudié du saumon fumé a mis en exergue la multitude d offres disponibles en termes de MDD+ et de labels. Le décalage entre le positionnement voulu et le positionnement perçu L attitude des clients vis à vis des MDD ne cesse de s améliorer : certains acheteurs inconditionnels de MDD considèrent même que le prix des MN est sujet à caution et que c est la MDD qui indique le «prix juste» (10). L achat de MDD correspond donc à un «achat malin». Les tests gustatifs en aveugle donnent souvent raison à cet engouement des consommateurs pour les MDD. Une récente enquête a par exemple
18 montré que pour 11 catégories de produits sur 15 testées (Capital, 2010), la MDD était préférée à la MN leader. Ce résultat s explique assez bien aujourd hui car la plupart des enseignes en font un critère de lancement de leurs produits : elles testent dans leurs laboratoires le goût des produits MDD et ne les lancent que s ils sont perçus comme au moins aussi bon que le produit de la MN cible. Or, nos résultats montrent que, sur la catégorie de produits étudiée, la qualité perçue par les clients est significativement moins élevée pour les MDD classiques que pour les MN. Plus encore, les MDD+ ne parviennent pas, même en faisant appel à des stratégies de labellisation, à démontrer leur supériorité qualitative sur les MN. Afin de renforcer la qualité perçue, les enseignes ont probablement intérêt à faire découvrir la qualité intrinsèque des produits à travers des expériences directes avec le produit (dégustations en magasin, échantillons gratuits, etc.) et à travailler les packagings en détaillant davantage les attributs de la qualité des produits, avec un discours publicitaire allant également dans ce sens, tout en assurant une image-prix qui reste faible : mise en avant promotionnelle, réduction de prix, etc. L évaluation de la qualité des produits décrite ci dessus (MN équivalente aux MDD+ et supérieures aux MDD classiques) est le reflet de la politique de prix des enseignes. Les clients ne semblent donc pas avoir intégré l idée d un rapport qualité / prix supérieur pour les MDD. Peut-être ce résultat varierait-il selon les enseignes, Monoprix ayant des clients moins sensibles aux prix d autres enseignes? Néanmoins, la question du positionnement prix des MDD reste posée, en particulier pour les MDD premium. On peut se demander si la stratégie «premium lite» poursuivie par la grande majorité des enseignes permet réellement aux enseignes d affirmer la suprématie qualitative de leurs produits MDD+, et ce d autant plus que la politique de prix n est pas toujours comparable d une catégorie à l autre pour une même MDD. Labelliser la MDD classique? L expérimentation menée en sortie de caisse montre que seules les MDD classiques semblent avoir un réel intérêt à être labellisées, puisque la qualité perçue s en trouve fortement améliorée. Ce faisant, via le lien qualité-prix, le label dégrade l image prix de la MDD classique : les produits proposés évoluent ainsi vers un autre segment de marché, plus qualitatif et directement en concurrence avec les MDD+ et des MN. En choisissant la stratégie de labellisation pour renforcer la qualité perçue de la MDD classique, les enseignes doivent faire face à un risque de brouillage de l image des
19 différentes gammes au sein du portefeuille de MDD des enseignes. Rappelons qu à ce jour, seule l enseigne Leclerc privilégie cette piste en labellisant directement les produits de sa MDD classique Repère (avec les labels AOC, Label Rouge, Max Havelaar). Mais, de ce fait, elle ne développe pas de MDD+ spécifiques. Quelles conséquences pour les organismes de labellisation officiels? Les résultats de cette recherche peuvent interpeller les instances en charge des labels officiels. Ces labels n apparaissent pas suffisamment différenciants pour les marques et tendent à devenir, au mieux, «le plus petit dénominateur commun de la qualité» selon un responsable d enseigne. Face à l amélioration gustative et sanitaire des marques disponibles en linéaire, il devient dès lors crucial pour les pouvoirs publics de réaffirmer l intérêt des labels pour les consommateurs, non en tant que tels, mais au regard des marques actuelles : dans un contexte sans crise alimentaire, MDD+ et MN étant positionnées sur l axe qualité et plaisir, l intérêt du label est loin d être évident pour les consommateurs. Un véritable effort de réflexion est donc à fournir sur les avantages concurrentiels différenciants des produits labellisés. Cet effort semble devoir être impulsé par les pouvoirs publics et les producteurs. Un des axes de réflexion consiste à faire prendre conscience aux consommateurs que les dimensions intrinsèques et extrinsèques de la qualité valorisées dans le cahier des charges sont fondamentaux pour expliquer le jugement sur la qualité globale, ce qui n apparaît pas aujourd hui (la dimension «respect de l environnement» n est pas suffisamment liée à ce jugement de qualité). Il peut s agir de la valorisation des circuits courts, de l empreinte carbone, de l argument santé lorsqu il existe, etc. Cette réflexion est d autant plus importante que le label peut générer des inférences négatives pour le consommateur : par exemple, l image prix du bio s avère préjudiciable, alors même que nos relevés de prix révèlent un positionnement relativement peu cher sur cette catégorie de produits (étude 1). Des initiatives pour diminuer cette image de cherté commencent à être menées par les distributeurs : le bio bénéficie d un élargissement des assortiments, de stratégies de positionnement bas prix promotionnelles ou permanentes (lebiomoinscher.com de Leclerc, ou 50 produits bio à moins de 1 euro pour Auchan) mais sont directement liées aux capacités de production, encore insuffisantes, et au soutien des pouvoirs publics. A
20 ce titre le logo européen biologique, nouvellement obligatoire, doit fournir l opportunité de mettre en place une véritable stratégie de communication visant non seulement à établir sa reconnaissance et sa notoriété, mais aussi à affirmer l intérêt qu il représente concrètement pour les consommateurs. De manière générale, la campagne de communication des labels officiels doit répondre explicitement aux inférences négatives générées par certains labels (effet prix, arnaque marketing, faible durée de conservation, etc.). Le discours sur le label ne peut plus se réduire à une «simple» marque officielle qui serait par essence une chance pour les producteurs et les consommateurs. Ce n est pas le cas et les concurrents. Les Pouvoirs publics doivent intégrer les effets contre-productifs d un outil incitatif insuffisamment pensé comme un outil marketing. Cela signifie qu à l instar des entreprises privées, il s agit de mettre en place une véritable stratégie de marquelabel, avec une marque mère (le label européen) et d éventuelles marque-filles (les Etats-Unis ont par exemple trois labels biologiques selon le degré de présence d ingrédients biologiques 70%, 90% ou 95%), correspondant à un véritable modèle de production inspiré des circuits courts. L absence d effet du label AB sur la MDD+ signifie que le distributeur pourrait, en théorie, s affranchir de la labellisation officielle sur sa marque thématique spécialisée. Bien évidemment, si le label ne paraît pas indispensable, c est sans doute grâce au capital de confiance construit patiemment par les MDD thématiques. Néanmoins, ce résultat a des implications fortes en termes de régulation et justifie pleinement l interdiction qui est faite aux marques de mettre en place des stratégies de «me too» labels, d auto-labellisation ou d utilisation de marques sans le label officiel (il est interdit d utiliser Monoprix Bio sans le label AB, mais Reflets de France n est pas contraint à utiliser les AOP). L'adoption d'une réglementation européenne interdisant l'usage de termes généralement considérés par le consommateur comme une référence au mode de production biologique (Bio, écolo, etc.) apparaît donc nécessaire mais pas suffisante. Finalement, penser le label du point de vue des consommateurs, i.e. d un point de vue marketing et non seulement légal, paraît une condition de survie à terme des labels officiels actuels et une condition de réussite de ceux à venir. Aujourd hui, des initiatives privées se créent, à l image de la mise en place de la marque (label «non officiel»?) Produit en Bretagne, créée conjointement par des industriels bretons (Even, Chancerelle, Doux, Hénaff, Savéol et Saupiquet) et des
21 distributeurs (Leclerc, Intermarché, Casino et Carrefour). L idée est d inciter les habitants de la région et les touristes de passage à acheter les produits régionaux. Des budgets importants (plus de en 2009) sont consacrés à stratégie de communication de ce label régional : presse quotidienne régionale, événementiels (Nuit celtique au stade de France), foires commerciales pour faire connaître ses produits labellisés ou trophées offrant aux lauréats un an de référencement en grande distribution. En développant une véritable stratégie de marque pour ce label, la grande distribution est devenue un acteur majeur du développement des produits régionaux et de la promotion des circuits courts. Ce type d initiative a des retombées directes en termes d emplois et de maintien de la culture locale, même si elle apparaît éloignée de la vision officielle et ministérielle des labels. Afin d étendre cette étude, il peut être utile d explorer d autres catégories de produits, d autres enseignes, d autre signes de qualité et les éventuels effets de surinformation que peut créer la multiplication des labels pour chaque dimension de la qualité non observée (lorsqu un produit d une MDD thématique comporte à la fois son logo, celui de Max Havelaar, le logo AB et le logo bio européen, le logo régional, comment le client interprète-t-il cette profusion de signes?). Une autre piste serait d explorer la capacité d évocation des divers pictogrammes utilisés, sachant que nombre de logo de MDD tendent à apparaître comme des signaux de qualité en eux-mêmes aux yeux des consommateurs : Grand Jury, Marque Repère, filière qualité Carrefour, etc. (1). Enfin, de nouveaux enjeux apparaissent avec les inscriptions concernant l empreinte carbone du produit. Tesco prévoit par exemple d établir un bilan carbone pour références et en France, Casino va afficher un logo informatif pour 3000 produits MDD. Sachant qu une très grande partie de l offre alimentaire labellisée AB provient aujourd hui de Chine, cette information risque de venir en contradiction avec le principe de respect de l environnement, affaiblissant un peu plus le sens des labels actuels. Si les MN ont été les premières à utiliser les labels officiels, sur ce nouveau territoire de communication avec le client, les MDD ont pris une longueur d avance, poussant les Pouvoirs publics à réfléchir à une véritable réflexion marketing sur leurs outils incitatifs.
22 Bibliographie (1) -- (2) -- (3) Bonnet C. et Simioni M. (2001), Assessing consumer response to Protected Designation of Origin labelling: a mixed multinomial logit approach, European Review of Agricultural Economics, 28, 4, (4) Breton P. (2004), Les Marques de distributeurs : les MDD ne sont pas que des copies!, Dunod. (5) Combris P., Lange C. et Issanchou S. (2002), Assessing the Effect of Information on the Reservation Price for champagne: Second-price compared to BDM Auctions with unspecified pricebounds. 6èmes Journées d Economie Expérimentale, Paris. (6) Cegara J.J. et Michel G. (2003), Alliances de marques : quel profit pour les marques partenaires?, Revue Française de Gestion, 145, 4, (7) Hassan, D. et Monier-Dilhan S. (2006), National brands and store brands: competition through public quality labels, Agribusiness, vol. 22, n 1, pp (8) Hassan, D., Réquillart V. et Monier-Dilhan S. (2006), Signes officiels de qualité : éléments de bilan d'une politique publique, Recherche en Economie et Sociologie Rurale, INRA, Novembre, n 5-6. (9) Kumar N. et Steenkamp J-B.E.M. (2007), Private label strategy: how to meet the Store Brand Challenge, Harvard Business School Press, Boston. (10) Moati P. (2009), les consommateurs trouvent les prix «injustes», Consommation et Modes de Vie, Cahier de Recherche du Credoc, n 220, avril. (11) Rao A.R. et Ruekert R.W. (1994), Brand alliances as signals of product quality, Sloan Management Review, 36, 1, (12) Rao A. (2005), The Quality of Price as a Quality Cue, Journal of Marketing Research, 42, 4, (13) Rao A., Akshay R. and Monroe K.B. (1989), The Effect of Price, Brand Name, and Store Name on Buyers' Perceptions of Product Quality: An Integrative Review, Journal of Marketing Research, 26, August, (14) Sirieix L., Pontier S. et Schaer B. (2004), Orientations de la confiance et choix du circuit de distribution : Le cas des produits biologiques, Actes du 20ème Congrès de l'association Française de Marketing, Saint-Malo.
23 (15) Tagbata D. et Sirieix L. (2007), Les effets des labels «bio» et «commerce équitable» sur le consentement à payer des chocolats, cahier de recherche n 2, SupAgro, UMR1110 MOISA. (16) Tellis, G. et Wernerfelt B. (1987), Competitive Price and Quality Under Asymmetric Information, Marketing Science, 6, Summer,
24 Annexe 1 : Label AB et Label Rouge Le label Biologique AB : crée en 1986, ce label garantit essentiellement un procédé de fabrication strict, défini dans un cahier des charges imposé aux producteurs. Les contrôles réglementaires interdisent les OGM, les intrants chimiques de synthèse, etc. Par exemple, pour qu un saumon fumé soit labellisé AB, il est exigé un bon renouvellement des eaux, suffisamment d oxygène, une densité de poisson inférieure à 20kg/m 3, une alimentation composée essentiellement d ingrédients issus du mode de production biologique, etc. Ces procédés sont certifiés par un organisme agréé par les pouvoirs publics (en particulier Ecocert) et encadrés par la norme européenne EN En 2008, le label AB est connu de 85% des Français (source CSA / Agence Bio). D après une étude TNS Sofres de 2009, il s agit encore majoritairement d achats occasionnels. Le marché du bio, évalué à plus de 3 milliards d euros, représente moins de 2 % du marché alimentaire national, mais les taux de croissance annuels sont à deux chiffres (entre 20 et 30% selon les catégories de produits), soutenus par l augmentation des MDD labellisées (Agence Bio). Le Label Rouge : créé en 1960, il impose un processus de production rigoureux ainsi que des tests gustatifs, à la différence du label AB. Par exemple, pour les saumons fumés, un test sensoriel indépendant est réalisé deux fois par an. Le cahier des charges impose une sélection d espèces à croissance lente, un mode d'élevage à densité limitée, une proportion élevée de protéines de source marine dans l'aliment, ainsi que des procédés de transformation rigoureux (parage sévère, salage au sel sec, fumage traditionnel), et finalement un taux de matières grasses sur le saumon frais limité à 16%. Spécifique à la France, le Label Rouge est le plus connu des labels avec 92% de notoriété (Source Crédoc 2007). D après une étude Opinion Way de 2010, 94% des français savent qu ils peuvent trouver ce label en grande distribution et ils sont 87% à déclarer en avoir déjà consommé. La «réalité» de la supériorité gustative des produits est montré par l étude des experts de Que Choisir (n 476, 2009) : sur les 20 références de saumons fumés testées, les quatre premières places sont obtenues par des marques labellisées Label Rouge.
25 Annexe 2 - Différences et points communs entre MN, MDD, labels et allégations Statut juridique Caution et propriétaire Acteurs Utilisation MN Marque nationale Marques simples Caution apportée par le producteur de la marque, spécialiste de la catégorie Le producteur propose une offre à partir de son propre cahier des charges Généralement limitée à une catégorie de produits, dans de multiples enseignes MDD Marque distributeur Marques simple de Caution apportée par le distributeur propriétaire via le transfert de confiance de l enseigne aux références MDD Le distributeur établit le cahier des charges du produit et sélectionne un producteur qui y satisfait Sur de multiples catégories de produits, dans une seule enseigne Labels ou MCC Marque collective de certification Marques collectives Caution apportée par l organisme extérieur mandaté par le Ministère de l Agriculture (propriétaires des labels AB et Rouge) L organisme certificateur établit le cahier des charges du label et vérifie son respect par le producteur Sur de multiples catégories de produits, dans de multiples enseignes, sur de multiples marques Allégations Autres logos Non déposées ou marques simples aucune Certains producteurs ou distributeurs Sur de multiples catégories de produits, dans de multiples enseignes, sur de multiples marques Extrait l ordonnance n du 6 mai art. 1 Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de le fait : 1) De délivrer une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L du code rural et de la pêche maritime ; 2) De délivrer une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue respectivement aux articles L , L et L du code rural et de la pêche maritime ; 3) D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie ; 4) D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie en les sachant inexactes ; 5) D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie ; 6) De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une spécialité traditionnelle garantie, d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée est garanti par l'etat ou par un organisme public.
26 Annexe 3 : Stimuli présentés aux répondants Ventilation des effectifs de l expérimentation en terrain réel Type de marque évalué MDD M MDD+ Monoprix Gourmet / Bio MN+ Labeyrie Sans label Label AB Label Rouge Total Total Une limite de cette expérimentation concerne la marque thématique non labellisée utilisée : par souci de réalisme, il s agit de la MDD+ Monoprix Gourmet, différente de la marque thématique Bio utilisée dans le cas de la labellisation AB puisqu il s agit de la MDD+ qui comporte la majorité des références labellisées AB. Des variables telles que la fréquence d achat, le sexe et l âge, susceptibles d influencer la perception des variables dépendantes, ont été contrôlées dans les différents traitements statistiques. La distribution des variables est normale et autorise les analyses de variances. Les différences obtenues résultent de la variation des stimuli présentés aux clients.
27 Annexe 4 - Effet du label AB sur la perception des MN 7,00 6,00 5,00 5,87 5,66 4,50 5,03 4,88 4,81 4,00 3,00 3,65 3,73 MN MN AB 2,00 1,73 1,42 1,70 1,90 1,00 0,00 Qualité globale Prix moyen Qualité/prix Goût Elevage respectueux Risque perçu Différence significative (p=0,05)
28 Annexe 5 Effet du Label Rouge sur la perception des trois types de marques Effet du Label Rouge sur la perception de la MDD classique M de Monoprix 5,00 4,73 4,00 3,00 2,00 3,60 2,49 2,10 2,07 2,62 2,87 3,33 2,37 3,80 2,50 1,83 MDD MDD LR 1,00 0,00 Qualité globale Prix moyen Qualité/prix Goût Elevage respectueux Risque perçu Différence significative (p=0,05) Effet du Label Rouge sur la perception de la MDD+ Monoprix Gourmet 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 5,44 5,21 3,27 3,93 2,01 1,67 4,41 3,79 3,63 3,00 1,63 1,91 MDD+ MDD+ LR 1,00 0,00 Qualité globale Prix moyen Qualité/prix Goût Elevage respectueux Risque perçu Effet du Label Rouge sur la perception de la MN Labeyrie 7,00 6,00 5,00 5,87 6,11 5,03 5,32 4,61 4,00 3,00 3,65 3,55 2,49 3,73 MN MN LR 2,00 1,00 1,73 1,70 1,14 0,00 Qualité globale Prix moyen Qualité/prix Goût Elevage respectueux Risque perçu
72% des Français prêts à payer plus cher un produit fabriqué en France. Mais pas à n importe quel prix!
 Communiqué de presse 21 novembre 2011 Une étude CEDRE/Ifop 1 propose le regard croisé des consommateurs et des chefs d entreprises français sur le «Made in France» 72% des Français prêts à payer plus cher
Communiqué de presse 21 novembre 2011 Une étude CEDRE/Ifop 1 propose le regard croisé des consommateurs et des chefs d entreprises français sur le «Made in France» 72% des Français prêts à payer plus cher
La marque : clé du succès de la stratégie commerciale dans un marché global
 La marque : clé du succès de la stratégie commerciale dans un marché global Historique Les marques existent depuis les premiers échanges commerciaux et servaient essentiellement à authentifier l origine
La marque : clé du succès de la stratégie commerciale dans un marché global Historique Les marques existent depuis les premiers échanges commerciaux et servaient essentiellement à authentifier l origine
CHAPITRE IV. 4.1 Stratégies d internationalisation des enseignes françaises
 72 CHAPITRE IV 1. La grande distribution française 4.1 Stratégies d internationalisation des enseignes françaises La distribution française est une des plus importantes au niveau mondial, en raison de
72 CHAPITRE IV 1. La grande distribution française 4.1 Stratégies d internationalisation des enseignes françaises La distribution française est une des plus importantes au niveau mondial, en raison de
B.T.S. N.R.C. SESSION 2006 Management et gestion d'activités commerciales. Proposition de Corrigé "JAMPI" Dossier 1 L entreprise et son marché
 B.T.S. N.R.C. SESSION 2006 Management et gestion d'activités commerciales Proposition de Corrigé "JAMPI" Dossier 1 L entreprise et son marché Première partie : Analyse du marché à partir des annexes 1
B.T.S. N.R.C. SESSION 2006 Management et gestion d'activités commerciales Proposition de Corrigé "JAMPI" Dossier 1 L entreprise et son marché Première partie : Analyse du marché à partir des annexes 1
MARKETING MIX. Politique Produit. Les composantes d un produit POLITIQUE PRODUIT
 MARKETING MIX POLITIQUE PRODUIT Sandrine Monfort Politique Produit! Les composantes d un produit! Les classifications produit! Lancement produit! Politique de gamme! Politique de marque Les composantes
MARKETING MIX POLITIQUE PRODUIT Sandrine Monfort Politique Produit! Les composantes d un produit! Les classifications produit! Lancement produit! Politique de gamme! Politique de marque Les composantes
Circulaire du 7 juillet 2009
 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l économie, de l industrie et de l emploi NOR : ECEC0907743C Circulaire du 7 juillet 2009 concernant les conditions d application de l arrêté du 31 décembre 2008 relatif
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l économie, de l industrie et de l emploi NOR : ECEC0907743C Circulaire du 7 juillet 2009 concernant les conditions d application de l arrêté du 31 décembre 2008 relatif
L OBSERVATOIRE LCL EN VILLE - RÉALISÉ PAR BVA L ÉCONOMIE DU PARTAGE, ZOOM SUR LES JEUNES URBAINS. Juin 2014
 L OBSERVATOIRE LCL EN VILLE - RÉALISÉ PAR BVA L ÉCONOMIE DU PARTAGE, ZOOM SUR LES JEUNES URBAINS Juin 2014 Contacts BVA : Céline BRACQ Directrice BVA Opinion Lilas BRISAC Chargée d études 01 71 16 88 00
L OBSERVATOIRE LCL EN VILLE - RÉALISÉ PAR BVA L ÉCONOMIE DU PARTAGE, ZOOM SUR LES JEUNES URBAINS Juin 2014 Contacts BVA : Céline BRACQ Directrice BVA Opinion Lilas BRISAC Chargée d études 01 71 16 88 00
Y a t il une demande de sécurité sanitaire des consommateurs européens?
 Y a t il une demande de sécurité sanitaire des consommateurs européens? Eric Giraud Héraud INRA ALISS et Ecole Polytechnique, France Coll: Magda Aguiar Fontes (CIISA, Portugal), Pierre Combris (INRA ALISS),Alexandra
Y a t il une demande de sécurité sanitaire des consommateurs européens? Eric Giraud Héraud INRA ALISS et Ecole Polytechnique, France Coll: Magda Aguiar Fontes (CIISA, Portugal), Pierre Combris (INRA ALISS),Alexandra
Les stratégies commerciales et marketing de l entreprise bio BIOCONSEIL
 Les stratégies commerciales et marketing de l entreprise bio BIOCONSEIL Les stratégies commerciales et marketing de l entreprise bio Dans quels circuits de commercialisation vont évoluer vos produits?
Les stratégies commerciales et marketing de l entreprise bio BIOCONSEIL Les stratégies commerciales et marketing de l entreprise bio Dans quels circuits de commercialisation vont évoluer vos produits?
Le développement de la franchise dans le Groupe Casino
 Le développement de la franchise dans le Groupe Casino Dossier de presse 1 Communiqué de presse Le groupe Casino mise sur la franchise pour accélérer le développement de ses enseignes de proximité Mars
Le développement de la franchise dans le Groupe Casino Dossier de presse 1 Communiqué de presse Le groupe Casino mise sur la franchise pour accélérer le développement de ses enseignes de proximité Mars
LES CONDITIONS D ACCÈS AUX SERVICES BANCAIRES DES MÉNAGES VIVANT SOUS LE SEUIL DE PAUVRETÉ
 3. Les crédits 3.1 Les crédits en cours 3.1.1 Les ménages ayant au moins un crédit en cours Un peu plus du quart, 31%, des ménages en situation de déclarent avoir au moins un crédit en cours. Il s agit
3. Les crédits 3.1 Les crédits en cours 3.1.1 Les ménages ayant au moins un crédit en cours Un peu plus du quart, 31%, des ménages en situation de déclarent avoir au moins un crédit en cours. Il s agit
Étude sur les taux de revalorisation des contrats individuels d assurance vie au titre de 2013 n 26 mai 2014
 n 26 mai 2014 Étude sur les taux de revalorisation des contrats individuels d assurance vie au titre de 2013 Sommaire 1.INTRODUCTION 4 2.LE MARCHÉ DE L ASSURANCE VIE INDIVIDUELLE 6 2.1.La bancassurance
n 26 mai 2014 Étude sur les taux de revalorisation des contrats individuels d assurance vie au titre de 2013 Sommaire 1.INTRODUCTION 4 2.LE MARCHÉ DE L ASSURANCE VIE INDIVIDUELLE 6 2.1.La bancassurance
BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR ÉPREUVE DE MANAGEMENT DES ENTREPRISES BOITIER PHARMA
 BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR ÉPREUVE DE MANAGEMENT DES ENTREPRISES BOITIER PHARMA La commission de choix de sujets a rédigé cette proposition de corrigé, à partir des enrichissements successifs apportés
BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR ÉPREUVE DE MANAGEMENT DES ENTREPRISES BOITIER PHARMA La commission de choix de sujets a rédigé cette proposition de corrigé, à partir des enrichissements successifs apportés
réglementation bio Partie générale bio, reconnaissable et contrôlé
 réglementation bio Partie générale bio, reconnaissable et contrôlé Partie générale : bio, reconnaissable et contrôlé. L objectif de la partie générale de la brochure est de clarifier ce qu est exactement
réglementation bio Partie générale bio, reconnaissable et contrôlé Partie générale : bio, reconnaissable et contrôlé. L objectif de la partie générale de la brochure est de clarifier ce qu est exactement
Éléments de contexte. L univers des jardineries et graineteries
 Éléments de contexte L univers des jardineries et graineteries L univers étudié est constitué des établissements spécialisés dont l activité se caractérise par la distribution de végétaux, de fleurs, de
Éléments de contexte L univers des jardineries et graineteries L univers étudié est constitué des établissements spécialisés dont l activité se caractérise par la distribution de végétaux, de fleurs, de
PROTECTION DE PRODUITS EN IG
 PROTECTION DE PRODUITS EN IG Ousman ABDOU Ingénieur Agrométéorologue Expert de l Agriculture en IG Point focal IG/OAPI Direction Générale de l Agriculture Tel: (00227) 90 34 09 28 Email: [email protected]
PROTECTION DE PRODUITS EN IG Ousman ABDOU Ingénieur Agrométéorologue Expert de l Agriculture en IG Point focal IG/OAPI Direction Générale de l Agriculture Tel: (00227) 90 34 09 28 Email: [email protected]
La commandite. Comment créer des conditions gagnantes. 30 avril 2014
 La commandite Comment créer des conditions gagnantes 30 avril 2014 Qu est-ce que la commandite? Qu est-ce que la commandite? Une relation de partenariat dans laquelle le commanditaire investit pour accéder
La commandite Comment créer des conditions gagnantes 30 avril 2014 Qu est-ce que la commandite? Qu est-ce que la commandite? Une relation de partenariat dans laquelle le commanditaire investit pour accéder
ECOLE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES CORRIGÉ TYPE DE L EXAMEN
 ECOLE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES Module : Marketing Fondamental Niveau : 1 ère Année Master Enseignant : KHERRI Abdenacer Date : 13/04/2015 Site web : www.mf-ehec.jimdo.com Durée : 1 heure 30 minutes
ECOLE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES Module : Marketing Fondamental Niveau : 1 ère Année Master Enseignant : KHERRI Abdenacer Date : 13/04/2015 Site web : www.mf-ehec.jimdo.com Durée : 1 heure 30 minutes
Assurance et prévention des catastrophes naturelles et technologiques
 Assurance et prévention des catastrophes naturelles et technologiques Céline Grislain-Letrémy Résumé long - Thèse en sciences économiques sous la direction de Bertrand Villeneuve L objet de cette thèse
Assurance et prévention des catastrophes naturelles et technologiques Céline Grislain-Letrémy Résumé long - Thèse en sciences économiques sous la direction de Bertrand Villeneuve L objet de cette thèse
LE MARKETING DU CINEMA et de l AUDIOVISUEL. Présentation du Marketing appliqué au cinéma & à l audiovisuel
 LE MARKETING DU CINEMA et de l AUDIOVISUEL Présentation du Marketing appliqué au cinéma & à l audiovisuel Sommaire PRESENTATION GENERALE DU MARKETING: Qu est-ce que le Marketing? Introduction et définition
LE MARKETING DU CINEMA et de l AUDIOVISUEL Présentation du Marketing appliqué au cinéma & à l audiovisuel Sommaire PRESENTATION GENERALE DU MARKETING: Qu est-ce que le Marketing? Introduction et définition
Management Stratégique. Saïd YAMI Maître de Conférences en Sciences de Gestion ERFI/ISEM Université Montpellier 1 Cours de Master 1.
 Management Stratégique Saïd YAMI Maître de Conférences en Sciences de Gestion ERFI/ISEM Université Montpellier 1 Cours de Master 1 Plan du Module 3 Chap.3- Les modèles fondés sur la structure des marchés
Management Stratégique Saïd YAMI Maître de Conférences en Sciences de Gestion ERFI/ISEM Université Montpellier 1 Cours de Master 1 Plan du Module 3 Chap.3- Les modèles fondés sur la structure des marchés
FACE AUX DÉFIS ÉCOLOGIQUES
 L ENVIRONNEMENT EN FRANCE 2 FACE AUX DÉFIS ÉCOLOGIQUES des initiatives locales et des actions de long terme VERS UN RAPPROCHEMENT DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET DE L ENVIRONNEMENT? INTRODUCTION L OBSERVATION
L ENVIRONNEMENT EN FRANCE 2 FACE AUX DÉFIS ÉCOLOGIQUES des initiatives locales et des actions de long terme VERS UN RAPPROCHEMENT DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET DE L ENVIRONNEMENT? INTRODUCTION L OBSERVATION
Bien-être des salariés et performance des magasins entrent-ils dans le même caddie?
 18 2 e semestre 2012/HesaMag #06 Dossier spécial 7/34 Bien-être des salariés et performance des magasins entrent-ils dans le même caddie? La protection du bien-être au travail est un droit des salariés.
18 2 e semestre 2012/HesaMag #06 Dossier spécial 7/34 Bien-être des salariés et performance des magasins entrent-ils dans le même caddie? La protection du bien-être au travail est un droit des salariés.
Conseil Spécialisé fruits et légumes
 Conseil Spécialisé fruits et légumes Proposition d axes pour l expérimentation pour 2013/2015 dans la filière fruits et légumes frais (hors pomme de terre) 18 décembre 2012 FranceAgriMer Préparation de
Conseil Spécialisé fruits et légumes Proposition d axes pour l expérimentation pour 2013/2015 dans la filière fruits et légumes frais (hors pomme de terre) 18 décembre 2012 FranceAgriMer Préparation de
Le montant des garanties constituées aux fins du STPGV est-il excessif?
 Le montant des garanties constituées aux fins du STPGV est-il excessif? Kim McPhail et Anastasia Vakos* L e système canadien de transfert des paiements de grande valeur (STPGV) sert à effectuer les paiements
Le montant des garanties constituées aux fins du STPGV est-il excessif? Kim McPhail et Anastasia Vakos* L e système canadien de transfert des paiements de grande valeur (STPGV) sert à effectuer les paiements
L INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE : LE PREMIER SECTEUR ECONOMIQUE FRANCAIS
 1 L INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE : LE PREMIER SECTEUR ECONOMIQUE FRANCAIS xz Sabrina TONNERRE Juriste Master II Droit des activités économiques Option Droit de l agroalimentaire Sous la direction de Maître
1 L INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE : LE PREMIER SECTEUR ECONOMIQUE FRANCAIS xz Sabrina TONNERRE Juriste Master II Droit des activités économiques Option Droit de l agroalimentaire Sous la direction de Maître
Fiche descriptive d activités
 Fiche descriptive d activités Fiche descriptive d activités (FDA) La fiche descriptive d activités (FDA) dresse la liste de l ensemble des activités, recensées lors d enquêtes, exercées par des titulaires
Fiche descriptive d activités Fiche descriptive d activités (FDA) La fiche descriptive d activités (FDA) dresse la liste de l ensemble des activités, recensées lors d enquêtes, exercées par des titulaires
Malgré une image des banques entachée par la crise, les Français restent très attachés à leur agence bancaire
 Résultats de l enquête Ifop/Wincor sur les relations des Français à leur agence bancaire Malgré une image des banques entachée par la crise, les Français restent très attachés à leur agence bancaire -
Résultats de l enquête Ifop/Wincor sur les relations des Français à leur agence bancaire Malgré une image des banques entachée par la crise, les Français restent très attachés à leur agence bancaire -
Conséquences des changements de mode de vie sur la production et la distribution des biens de consommation : résultats d une étude du CRÉDOC
 Conséquences des changements de mode de vie sur la production et la distribution des biens de consommation : résultats d une étude du CRÉDOC L industrie française des biens de consommation prend-elle bien
Conséquences des changements de mode de vie sur la production et la distribution des biens de consommation : résultats d une étude du CRÉDOC L industrie française des biens de consommation prend-elle bien
Les dirigeants face à l innovation
 Les dirigeants face à l innovation Vague 2 FACD N 111164 Contact Ifop : Flore-Aline Colmet Daâge Directrice d Etudes Département Opinion et Stratégies d'entreprise [email protected] Mai
Les dirigeants face à l innovation Vague 2 FACD N 111164 Contact Ifop : Flore-Aline Colmet Daâge Directrice d Etudes Département Opinion et Stratégies d'entreprise [email protected] Mai
Analyse des évolutions de l agriculture biologique par le biais de la veille documentaire et technologique
 Analyse des évolutions de l agriculture biologique par le biais de la veille documentaire et technologique Auteurs : Sophie Valleix, responsable d ABioDoc et Esméralda Ribeiro, documentaliste à ABioDoc
Analyse des évolutions de l agriculture biologique par le biais de la veille documentaire et technologique Auteurs : Sophie Valleix, responsable d ABioDoc et Esméralda Ribeiro, documentaliste à ABioDoc
ilottery 2.0 DÉVELOPPER LE JEU En collaboration avec
 ilottery 2.0 DÉVELOPPER LE JEU L I V R E B L A N C En collaboration avec RÉSUMÉ 2 Ce livre blanc repose sur une étude commandée par Karma Gaming et réalisée par Gaming Insights Group. Les données viennent
ilottery 2.0 DÉVELOPPER LE JEU L I V R E B L A N C En collaboration avec RÉSUMÉ 2 Ce livre blanc repose sur une étude commandée par Karma Gaming et réalisée par Gaming Insights Group. Les données viennent
DEMARCHE MARKETING MODULE : Aouichaoui Moez BTS : Conseiller d apprentissage. [email protected]. Démarche Marketing
 2012/2013 Démarche Marketing MODULE : BTS : DEMARCHE MARKETING Aouichaoui Moez Conseiller d apprentissage [email protected] - Janvier 2014 www.logistiquetn.me.ma, Tunis Aouichaoui Moez 1 Plan N.B
2012/2013 Démarche Marketing MODULE : BTS : DEMARCHE MARKETING Aouichaoui Moez Conseiller d apprentissage [email protected] - Janvier 2014 www.logistiquetn.me.ma, Tunis Aouichaoui Moez 1 Plan N.B
Evolution des risques sur les crédits à l habitat
 Evolution des risques sur les crédits à l habitat n 5 février 2012 1/17 SOMMAIRE 1. PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE LA PRODUCTION... 4 2. ANALYSE DÉTAILLÉE DES INDICATEURS DE RISQUE... 8 2.1 Montant moyen
Evolution des risques sur les crédits à l habitat n 5 février 2012 1/17 SOMMAIRE 1. PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE LA PRODUCTION... 4 2. ANALYSE DÉTAILLÉE DES INDICATEURS DE RISQUE... 8 2.1 Montant moyen
FORMULES DE CALCUL. Prix = PV TTC = PV HT x (1 + taux de TVA) TVA = PV HT x taux de TVA PV HT = PV TTC 1 + taux de TVA
 FORMULES DE CALCUL Le prix : Prix = PV TTC = PV HT x (1 + taux de TVA) TVA = PV HT x taux de TVA PV HT = PV TTC 1 + taux de TVA Ex : PV TTC = 250 x 1,196 = 299. TVA = 250 x 19,6 % = 49. PV HT = 299 = 250.
FORMULES DE CALCUL Le prix : Prix = PV TTC = PV HT x (1 + taux de TVA) TVA = PV HT x taux de TVA PV HT = PV TTC 1 + taux de TVA Ex : PV TTC = 250 x 1,196 = 299. TVA = 250 x 19,6 % = 49. PV HT = 299 = 250.
Chiffre d affaires de Casino unité : million d euros / Source : Casino
 Septembre 2012 / TBI&LMO / BPE 2ENT18 Chiffre d affaires de Casino unité : million d euros / Source : Casino 40 000 34 361 NAF rév.2, 2008 : Chiffres clés 2011 47.11CDEF 47.91B 30 000 20 000 20 390 22
Septembre 2012 / TBI&LMO / BPE 2ENT18 Chiffre d affaires de Casino unité : million d euros / Source : Casino 40 000 34 361 NAF rév.2, 2008 : Chiffres clés 2011 47.11CDEF 47.91B 30 000 20 000 20 390 22
Formation PME Etude de marché
 Formation PME Etude de marché Fit for Business (PME)? Pour plus de détails sur les cycles de formation PME et sur les business-tools, aller sous www.banquecoop.ch/business L étude de marché ou étude marketing
Formation PME Etude de marché Fit for Business (PME)? Pour plus de détails sur les cycles de formation PME et sur les business-tools, aller sous www.banquecoop.ch/business L étude de marché ou étude marketing
Comment évolue le Category
 Comment évolue le Category Management dans les enseignes multicanal? 5e rendez-vous du category management - paris 12-14 décembre 2012 Remerciements Florence Guittet et Serge Cogitore, enseignants du Master
Comment évolue le Category Management dans les enseignes multicanal? 5e rendez-vous du category management - paris 12-14 décembre 2012 Remerciements Florence Guittet et Serge Cogitore, enseignants du Master
LES CARTES À POINTS : POUR UNE MEILLEURE PERCEPTION
 LES CARTES À POINTS : POUR UNE MEILLEURE PERCEPTION DES NOMBRES par Jean-Luc BREGEON professeur formateur à l IUFM d Auvergne LE PROBLÈME DE LA REPRÉSENTATION DES NOMBRES On ne conçoit pas un premier enseignement
LES CARTES À POINTS : POUR UNE MEILLEURE PERCEPTION DES NOMBRES par Jean-Luc BREGEON professeur formateur à l IUFM d Auvergne LE PROBLÈME DE LA REPRÉSENTATION DES NOMBRES On ne conçoit pas un premier enseignement
Les Français et les nuisances sonores. Ifop pour Ministère de l Ecologie, du Développement Durable et de l Energie
 Les Français et les nuisances sonores Ifop pour Ministère de l Ecologie, du Développement Durable et de l Energie RB/MCP N 112427 Contacts Ifop : Romain Bendavid / Marion Chasles-Parot Département Opinion
Les Français et les nuisances sonores Ifop pour Ministère de l Ecologie, du Développement Durable et de l Energie RB/MCP N 112427 Contacts Ifop : Romain Bendavid / Marion Chasles-Parot Département Opinion
Panorama de la grande distribution alimentaire en France
 N 25 Février 2014 Service du soutien au réseau Sous-direction de la communication, programmation et veille économique Bureau de la veille économique et des prix Panorama de la grande distribution alimentaire
N 25 Février 2014 Service du soutien au réseau Sous-direction de la communication, programmation et veille économique Bureau de la veille économique et des prix Panorama de la grande distribution alimentaire
Projet Fish & Catering Sector (Mise à jour du 13/10/08)
 Projet Fish & Catering Sector (Mise à jour du 13/10/08) Une initiative conjointe de : En association avec : A. Introduction de la notion «d alimentation durable» en restauration collective. La notion «d
Projet Fish & Catering Sector (Mise à jour du 13/10/08) Une initiative conjointe de : En association avec : A. Introduction de la notion «d alimentation durable» en restauration collective. La notion «d
«COMMENT PROSPECTER ET FIDÉLISER VOS CLIENTS GRÂCE À LA COMMUNICATION ET AU MARKETING DIRECT?»
 «COMMENT PROSPECTER ET FIDÉLISER VOS CLIENTS GRÂCE À LA COMMUNICATION ET AU MARKETING DIRECT?» Sommaire 1. Introduction : les clients, les Médias et la Publicité 2. Construire une Stratégie de Communication
«COMMENT PROSPECTER ET FIDÉLISER VOS CLIENTS GRÂCE À LA COMMUNICATION ET AU MARKETING DIRECT?» Sommaire 1. Introduction : les clients, les Médias et la Publicité 2. Construire une Stratégie de Communication
Les entreprises familiales vues par les actifs Français.
 Les entreprises familiales vues par les actifs Français. Janvier 2014 Chaire Entrepreneuriat Familial et Société entre pérennité et changement Contacts : Noémie Lagueste Chargée d études Chaire Entrepreneuriat
Les entreprises familiales vues par les actifs Français. Janvier 2014 Chaire Entrepreneuriat Familial et Société entre pérennité et changement Contacts : Noémie Lagueste Chargée d études Chaire Entrepreneuriat
Table des matières. Partie I La marque en idée... 7. Remerciements... XVII Avant-propos... XIX Introduction... 1
 Table des matières Remerciements....................................................................... XVII Avant-propos.......................................................................... XIX Introduction...........................................................................
Table des matières Remerciements....................................................................... XVII Avant-propos.......................................................................... XIX Introduction...........................................................................
CECOP. Centre d études et de connaissances sur l opinion publique LES FRANCAIS ET LEUR RETRAITE. Une enquête CECOP/CSA pour Le Cercle des épargnants
 Centre d études et de connaissances sur l opinion publique LES FRANCAIS ET LEUR RETRAITE Une enquête /CSA pour Le Cercle des épargnants Note d analyse Février 2009 S.A. au capital de 38.112,25 euros Siège
Centre d études et de connaissances sur l opinion publique LES FRANCAIS ET LEUR RETRAITE Une enquête /CSA pour Le Cercle des épargnants Note d analyse Février 2009 S.A. au capital de 38.112,25 euros Siège
LES FRANÇAIS ET LA COMPLEMENTAIRE SANTE
 Centre de Recherche pour l Etude et l Observation des Conditions de Vie LES FRANÇAIS ET LA COMPLEMENTAIRE SANTE Anne LOONES Marie-Odile SIMON Août 2004 Département «Evaluation des Politiques Sociales»
Centre de Recherche pour l Etude et l Observation des Conditions de Vie LES FRANÇAIS ET LA COMPLEMENTAIRE SANTE Anne LOONES Marie-Odile SIMON Août 2004 Département «Evaluation des Politiques Sociales»
Les imperfections de concurrence dans l industrie bancaire : spécificités et conséquences
 Les imperfections de concurrence dans l industrie bancaire : spécificités et conséquences Entretiens Enseignants Entreprises Jean-Paul POLLIN 30 août 2012 Laboratoire d Economie d Orléans (LEO) 1 Plan
Les imperfections de concurrence dans l industrie bancaire : spécificités et conséquences Entretiens Enseignants Entreprises Jean-Paul POLLIN 30 août 2012 Laboratoire d Economie d Orléans (LEO) 1 Plan
Produits laitiers de ferme
 Produits laitiers de ferme Produits laitiers de ferme CRIOC, novembre 2008 Agenda 1. Objectifs 2. Méthodologie 3. Consommation de produits laitiers de ferme 4. Perception des produits laitiers de ferme
Produits laitiers de ferme Produits laitiers de ferme CRIOC, novembre 2008 Agenda 1. Objectifs 2. Méthodologie 3. Consommation de produits laitiers de ferme 4. Perception des produits laitiers de ferme
Rapport sur l intérêt des producteurs maraîchers de la région de Montréal quant aux modèles associatifs de mise en marché en circuits courts
 Rapport sur l intérêt des producteurs maraîchers de la région de Montréal quant aux modèles associatifs de mise en marché en circuits courts par Équiterre 30 novembre 2011 Objet de l étude Cette étude
Rapport sur l intérêt des producteurs maraîchers de la région de Montréal quant aux modèles associatifs de mise en marché en circuits courts par Équiterre 30 novembre 2011 Objet de l étude Cette étude
I. Les entreprises concernées et l opération
 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n 09-DCC-46 du 28 septembre 2009 relative à la prise en location-gérance par la société Distribution Casino France d un hypermarché détenu par la société Doremi L Autorité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n 09-DCC-46 du 28 septembre 2009 relative à la prise en location-gérance par la société Distribution Casino France d un hypermarché détenu par la société Doremi L Autorité
INNOVATION ET COMPORTEMENT
 INNOVATION ET COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR DANS LE SECTEUR AGROALIMENTAIRE Alejandro FUENTES ESPINOZA INRA ALISS, BORDEAUX IV Innovation et politique publique dans le secteur agroalimentaire 16 janvier
INNOVATION ET COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR DANS LE SECTEUR AGROALIMENTAIRE Alejandro FUENTES ESPINOZA INRA ALISS, BORDEAUX IV Innovation et politique publique dans le secteur agroalimentaire 16 janvier
Document explicatif Introduction à Fairtrade
 Document explicatif Introduction à Fairtrade Explication de quelques mots et expressions clés utilisés à Fairtrade. Coopérative de Café Cocla, Peru. Photo: Henrik Kastenskov Document: Document explicatif
Document explicatif Introduction à Fairtrade Explication de quelques mots et expressions clés utilisés à Fairtrade. Coopérative de Café Cocla, Peru. Photo: Henrik Kastenskov Document: Document explicatif
Introduction DROIT ET MARKETING ON LINE : QUELS ENJEUX? QUELLES RELATIONS?
 DROIT ET MARKETING ON LINE : QUELS ENJEUX? QUELLES RELATIONS? Internet : réseau des réseaux où tout semble possible; espace où l on peut tour à tour rechercher, apprendre, travailler, échanger; vecteur
DROIT ET MARKETING ON LINE : QUELS ENJEUX? QUELLES RELATIONS? Internet : réseau des réseaux où tout semble possible; espace où l on peut tour à tour rechercher, apprendre, travailler, échanger; vecteur
Etude de marché. Idée de depart. Etude de l environnement et des offres existantes. Clients. actuels. Choix de la cible précise
 Etude de marché Selon l Agence Pour la Création d Entreprise (APCE), 70% des cas de défaillance ont pour origine la mauvaise qualité des études de marché, que celles-ci soient mal réalisées ou de manière
Etude de marché Selon l Agence Pour la Création d Entreprise (APCE), 70% des cas de défaillance ont pour origine la mauvaise qualité des études de marché, que celles-ci soient mal réalisées ou de manière
Afidol. Etude d accès au marché Phase 5. Etude qualitative auprès de la Grande Distribution. Rapport final 31 mars 2011
 Afidol Etude d accès au marché Phase 5 Etude qualitative auprès de la Grande Distribution Rapport final 31 mars 2011 Etudes financées par l Union Européenne, France Agrimer et l Association Française Interprofessionnelle
Afidol Etude d accès au marché Phase 5 Etude qualitative auprès de la Grande Distribution Rapport final 31 mars 2011 Etudes financées par l Union Européenne, France Agrimer et l Association Française Interprofessionnelle
Etude Harris Interactive pour la Chambre Nationale des Services d Ambulances (CNSA)
 Note détaillée L image des ambulanciers Etude Harris Interactive pour la Chambre Nationale des Services d Ambulances (CNSA) Enquête réalisée en ligne du 17 au 19 septembre 2013. Echantillon de 985 personnes
Note détaillée L image des ambulanciers Etude Harris Interactive pour la Chambre Nationale des Services d Ambulances (CNSA) Enquête réalisée en ligne du 17 au 19 septembre 2013. Echantillon de 985 personnes
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
 Note détaillée Baromètre européen du rapport aux paiements Des pratiques uniformisées en Europe? Sondage Harris Interactive pour Crédit Agricole Cards & Payments Enquête réalisée en ligne du 19 au 29 septembre
Note détaillée Baromètre européen du rapport aux paiements Des pratiques uniformisées en Europe? Sondage Harris Interactive pour Crédit Agricole Cards & Payments Enquête réalisée en ligne du 19 au 29 septembre
Chap 1 : LA DEMARCHE MERCATIQUE
 I. La démarche mercatique globale A. Définition Chap 1 : LA DEMARCHE MERCATIQUE La mercatique est l ensemble des techniques et actions ayant pour objet de prévoir, constater, stimuler, susciter ou renouveler
I. La démarche mercatique globale A. Définition Chap 1 : LA DEMARCHE MERCATIQUE La mercatique est l ensemble des techniques et actions ayant pour objet de prévoir, constater, stimuler, susciter ou renouveler
Les français et les jeunes conducteurs
 DOSSIER DE PRESSE Paris, 4 mai 2015 www.jeune-conducteur-assur.com Les français et les jeunes conducteurs Révélation de l étude Jeune Conducteur Assur / Ifop Enquête menée auprès d un échantillon de 1000
DOSSIER DE PRESSE Paris, 4 mai 2015 www.jeune-conducteur-assur.com Les français et les jeunes conducteurs Révélation de l étude Jeune Conducteur Assur / Ifop Enquête menée auprès d un échantillon de 1000
LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES Anne DIETRICH Frédérique PIGEYRE 2005, repères, La découverte
 LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES Anne DIETRICH Frédérique PIGEYRE 2005, repères, La découverte La GRH constitue une préoccupation permanente de toute entreprise, de tout dirigeant, qu il s agisse de
LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES Anne DIETRICH Frédérique PIGEYRE 2005, repères, La découverte La GRH constitue une préoccupation permanente de toute entreprise, de tout dirigeant, qu il s agisse de
sentée e et soutenue publiquement pour le Doctorat de l Universitl
 Du rôle des signaux faibles sur la reconfiguration des processus de la chaîne de valeur de l organisation : l exemple d une centrale d achats de la grande distribution française Thèse présent sentée e
Du rôle des signaux faibles sur la reconfiguration des processus de la chaîne de valeur de l organisation : l exemple d une centrale d achats de la grande distribution française Thèse présent sentée e
MICHEL ET AUGUSTIN DOSSIER 1 : Conquérir un nouveau secteur géographique
 Session 2013 BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR NÉGOCIATION ET RELATION CLIENT Corrigé E5 : Management et gestion d activités commerciales VERSION 23 MAI 2013 MICHEL ET AUGUSTIN DOSSIER 1 : Conquérir un nouveau
Session 2013 BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR NÉGOCIATION ET RELATION CLIENT Corrigé E5 : Management et gestion d activités commerciales VERSION 23 MAI 2013 MICHEL ET AUGUSTIN DOSSIER 1 : Conquérir un nouveau
STRATÉGIE CLIENT : PROCESSUS D AFFAIRES. Alain Dumas, MBA, ASC, CPA, CA KPMG-SECOR
 STRATÉGIE CLIENT : PROCESSUS D AFFAIRES Alain Dumas, MBA, ASC, CPA, CA KPMG-SECOR Alain Dumas, MBA, ASC, CPA, CA Associé ALAIN DUMAS Associé KPMG-SECOR 555, boul. René-Lévesque Ouest, 9 e étage Montréal,
STRATÉGIE CLIENT : PROCESSUS D AFFAIRES Alain Dumas, MBA, ASC, CPA, CA KPMG-SECOR Alain Dumas, MBA, ASC, CPA, CA Associé ALAIN DUMAS Associé KPMG-SECOR 555, boul. René-Lévesque Ouest, 9 e étage Montréal,
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
 Organisation des Nations Unies pour le développement industriel Distr. générale 14 octobre 2014 Français Original: anglais Conseil du développement industriel Quarante-deuxième session Vienne, 25-27 novembre
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel Distr. générale 14 octobre 2014 Français Original: anglais Conseil du développement industriel Quarante-deuxième session Vienne, 25-27 novembre
Paris, 9 heures du matin, siège social d une multinationale agroalimentaire
 Introduction Paris, 9 heures du matin, siège social d une multinationale agroalimentaire Paul, chef de produit, s est réveillé ce matin avec un mauvais pressentiment qu il ne parvient pas encore à expliquer.
Introduction Paris, 9 heures du matin, siège social d une multinationale agroalimentaire Paul, chef de produit, s est réveillé ce matin avec un mauvais pressentiment qu il ne parvient pas encore à expliquer.
Le système d accréditation n est pas un système basé sur la conformité à la. de ce fait, il se différencie
 Système d accreditation des organismes de formation Origine, objectifs et méthodologie du système d accréditation Carlos Capela Coordinateur du projet INOFOR - Institut pour l innovation dans la formation
Système d accreditation des organismes de formation Origine, objectifs et méthodologie du système d accréditation Carlos Capela Coordinateur du projet INOFOR - Institut pour l innovation dans la formation
Monia Amami Franck Brulhart Raymond Gambini Pierre-Xavier Meschi
 Version 4.7 Simulation d Entreprise «Artemis» Monia Amami Franck Brulhart Raymond Gambini Pierre-Xavier Meschi p. 1 1. Objectifs et Contexte Général L objectif de la simulation d entreprise «Artemis» est
Version 4.7 Simulation d Entreprise «Artemis» Monia Amami Franck Brulhart Raymond Gambini Pierre-Xavier Meschi p. 1 1. Objectifs et Contexte Général L objectif de la simulation d entreprise «Artemis» est
Rapport d évaluation du master
 Section des Formations et des diplômes Rapport d évaluation du master Administration et gestion des entreprises de l Université de Versailles Saint- Quentin-en-Yvelines - UVSQ Vague E 2015-2019 Campagne
Section des Formations et des diplômes Rapport d évaluation du master Administration et gestion des entreprises de l Université de Versailles Saint- Quentin-en-Yvelines - UVSQ Vague E 2015-2019 Campagne
L OBSERVATOIRE DES CRÉDITS AUX MÉNAGES. Tableau de bord. 25 ème rapport annuel. Michel Mouillart Université Paris Ouest 29 Janvier 2013
 L OBSERVATOIRE DES CRÉDITS AUX MÉNAGES 25 ème rapport annuel Tableau de bord Michel Mouillart Université Paris Ouest 29 Janvier 2013 La photographie des ménages détenant des crédits que propose la 25 ième
L OBSERVATOIRE DES CRÉDITS AUX MÉNAGES 25 ème rapport annuel Tableau de bord Michel Mouillart Université Paris Ouest 29 Janvier 2013 La photographie des ménages détenant des crédits que propose la 25 ième
C R É D I T A G R I C O L E A S S U R A N C E S. Des attitudes des Européens face aux risques
 C R É D I T A G R I C O L E A S S U R A N C E S Observatoire Ipsos-LogicaBusiness Consulting/Crédit Agricole Assurances Des attitudes des Européens face aux risques Fiche technique Ensemble : 7245 répondants
C R É D I T A G R I C O L E A S S U R A N C E S Observatoire Ipsos-LogicaBusiness Consulting/Crédit Agricole Assurances Des attitudes des Européens face aux risques Fiche technique Ensemble : 7245 répondants
Format de l avis d efficience
 AVIS D EFFICIENCE Format de l avis d efficience Juillet 2013 Commission évaluation économique et de santé publique Ce document est téléchargeable sur www.has-sante.fr Haute Autorité de santé Service documentation
AVIS D EFFICIENCE Format de l avis d efficience Juillet 2013 Commission évaluation économique et de santé publique Ce document est téléchargeable sur www.has-sante.fr Haute Autorité de santé Service documentation
8 Certifications Minergie
 8 Chapitre 8 Être Minergie, est-ce aussi être «autrement»? Pour de nombreux acteurs du marché immobilier, un label de durabilité devrait s accompagner d une appréciation de la valeur de leur immeuble,
8 Chapitre 8 Être Minergie, est-ce aussi être «autrement»? Pour de nombreux acteurs du marché immobilier, un label de durabilité devrait s accompagner d une appréciation de la valeur de leur immeuble,
L ESSENTIEL DU PLAN MARKETING OPÉRATIONNEL
 GUÉNAËLLE BONNAFOUX CORINNE BILLON Sous la direction de NATHALIE VAN LAETHEM L ESSENTIEL DU PLAN MARKETING OPÉRATIONNEL LES ESSENTIELS DU MARKETING, 2013 ISBN : 978-2-212-55553-0 Sommaire Introduction
GUÉNAËLLE BONNAFOUX CORINNE BILLON Sous la direction de NATHALIE VAN LAETHEM L ESSENTIEL DU PLAN MARKETING OPÉRATIONNEL LES ESSENTIELS DU MARKETING, 2013 ISBN : 978-2-212-55553-0 Sommaire Introduction
Le déroulement de l animation
 10020_GererAnimer_p076p087 Page 83 Vendredi, 12. août 2005 9:00 09 Le déroulement de l animation DOSSIER 15 Correspondance référentiel Dossier Page livre élève Compétences professionnelles Savoirs associés
10020_GererAnimer_p076p087 Page 83 Vendredi, 12. août 2005 9:00 09 Le déroulement de l animation DOSSIER 15 Correspondance référentiel Dossier Page livre élève Compétences professionnelles Savoirs associés
DES EXEMPLES DE PROJETS PRESENTES EN PDUC
 Type d UC Outils du diagnostic Problématique Projet Magasin spécialisé dans la vente de produits pour l équitation Observation Analyse du compte de résultat Enquête clientèle Etude de concurrence Perte
Type d UC Outils du diagnostic Problématique Projet Magasin spécialisé dans la vente de produits pour l équitation Observation Analyse du compte de résultat Enquête clientèle Etude de concurrence Perte
LE PLAN D'AMÉLIORATION DE LA FONCTION MARKETING
 LE PLAN D'AMÉLIORATION DE LA FONCTION MARKETING Direction du développement des entreprises et des affaires Préparé par Michel Coutu, F. Adm.A., CMC Conseiller en gestion Publié par la Direction des communications
LE PLAN D'AMÉLIORATION DE LA FONCTION MARKETING Direction du développement des entreprises et des affaires Préparé par Michel Coutu, F. Adm.A., CMC Conseiller en gestion Publié par la Direction des communications
SÉNAT PROPOSITION DE LOI
 N 711 SÉNAT SECONDE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2009-2010 Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 septembre 2010 PROPOSITION DE LOI visant à limiter la production de viande provenant d animaux abattus
N 711 SÉNAT SECONDE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2009-2010 Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 septembre 2010 PROPOSITION DE LOI visant à limiter la production de viande provenant d animaux abattus
Décision n 10-DCC-20 du 24 février 2010 relative à l acquisition de ADT France par le groupe Stanley Works
 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n 10-DCC-20 du 24 février 2010 relative à l acquisition de ADT France par le groupe Stanley Works L Autorité de la concurrence, Vu le dossier de notification adressé complet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n 10-DCC-20 du 24 février 2010 relative à l acquisition de ADT France par le groupe Stanley Works L Autorité de la concurrence, Vu le dossier de notification adressé complet
Le rôle sociétal du café en entreprise
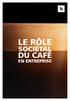 Le rôle sociétal du café en entreprise Fort de son expertise café, Nespresso Business Solutions a conduit avec l organisme IFOP une étude sur la place et le rôle du café en entreprise, et en dévoile les
Le rôle sociétal du café en entreprise Fort de son expertise café, Nespresso Business Solutions a conduit avec l organisme IFOP une étude sur la place et le rôle du café en entreprise, et en dévoile les
Programme de certification sans gluten
 Allergen Control Group Inc. L Allergen Control Group Inc. (ACG) est représenté par une équipe d experts de l industrie alimentaire, qui connaissent et comprennent comment gérer les risques lors de la fabrication,
Allergen Control Group Inc. L Allergen Control Group Inc. (ACG) est représenté par une équipe d experts de l industrie alimentaire, qui connaissent et comprennent comment gérer les risques lors de la fabrication,
BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR TERTIAIRES SESSION 2013
 La commission de choix de sujets a rédigé cette proposition de corrigé, à partir des enrichissements successifs apportés aux différents stades d élaboration et de contrôle des sujets. Pour autant, ce document
La commission de choix de sujets a rédigé cette proposition de corrigé, à partir des enrichissements successifs apportés aux différents stades d élaboration et de contrôle des sujets. Pour autant, ce document
Management Chapitre 4 La Stratégie I) La notion de stratégie A) Caractéristiques
 L Management Chapitre 4 La I) La notion de stratégie A) Caractéristiques 1) Définition a stratégie : consiste pour une entreprise, à se fixer des objectifs à long terme et à se donner les moyens de les
L Management Chapitre 4 La I) La notion de stratégie A) Caractéristiques 1) Définition a stratégie : consiste pour une entreprise, à se fixer des objectifs à long terme et à se donner les moyens de les
POUVOIR D ACHAT : la condition de vie des travailleurs
 POUVOIR D ACHAT : la condition de vie des travailleurs Séminaire CGTM Mercredi 19 mars 2008 Danielle LAPORT Sociologue Ingénieur Social Equipe de Recherche REV Université Paris XII Val-de-Marne Il me revient
POUVOIR D ACHAT : la condition de vie des travailleurs Séminaire CGTM Mercredi 19 mars 2008 Danielle LAPORT Sociologue Ingénieur Social Equipe de Recherche REV Université Paris XII Val-de-Marne Il me revient
En 2014, comment mener à bien une enquête aléatoire en population générale par téléphone?
 En 2014, comment mener à bien une enquête aléatoire en population générale par téléphone? Prémila Choolun 1, François Beck 2, Christophe David 1, Valérie Blineau 1, Romain Guignard 3, Arnaud Gautier 3,
En 2014, comment mener à bien une enquête aléatoire en population générale par téléphone? Prémila Choolun 1, François Beck 2, Christophe David 1, Valérie Blineau 1, Romain Guignard 3, Arnaud Gautier 3,
Les investissements internationaux
 Conclusion : Doit-on réguler les IDE? Les investissements internationaux Introduction : Qu est ce qu un investissement direct à l étranger (IDE)? I) L évolution des IDE 1 Les IDE : une affaire entre riches
Conclusion : Doit-on réguler les IDE? Les investissements internationaux Introduction : Qu est ce qu un investissement direct à l étranger (IDE)? I) L évolution des IDE 1 Les IDE : une affaire entre riches
ENQUÊTE FORUM DÉBAT 2002. Les Distributeurs du Secteur Dentaire
 ENQUÊTE FORUM DÉBAT 2002 Les Distributeurs du Secteur Dentaire [EDITO]. Le marché du matériel dentaire reste un domaine relativement parcellarisé sur le territoire français. Il est couvert par plus de
ENQUÊTE FORUM DÉBAT 2002 Les Distributeurs du Secteur Dentaire [EDITO]. Le marché du matériel dentaire reste un domaine relativement parcellarisé sur le territoire français. Il est couvert par plus de
Performance 2010. Eléments clés de l étude
 Advisory, le conseil durable Consulting / Operations Performance 2010 Eléments clés de l étude Ces entreprises qui réalisent deux fois plus de croissance. Une enquête sur les fonctions ventes et marketing.
Advisory, le conseil durable Consulting / Operations Performance 2010 Eléments clés de l étude Ces entreprises qui réalisent deux fois plus de croissance. Une enquête sur les fonctions ventes et marketing.
Les internautes et les comparateurs de prix
 FM N 19410 Contact L Atelier : Sandra Edouard Baraud Tél : 01 43 16 90 22 [email protected], Contact Ifop : Frédéric Micheau Tél : 01 45 84 14 44 [email protected] pour Les internautes
FM N 19410 Contact L Atelier : Sandra Edouard Baraud Tél : 01 43 16 90 22 [email protected], Contact Ifop : Frédéric Micheau Tél : 01 45 84 14 44 [email protected] pour Les internautes
choucroute Dossier de presse d lsace La Choucroute d Alsace comme vous ne l avez jamais goûtée DU 17 AU 25 janvier 2015
 La Choucroute d Alsace comme vous ne l avez jamais goûtée Dossier de presse Création graphique : Musiconair Pendant 9 jours, les Chefs d Alsace et les Maîtres Restaurateurs d Alsace vous font découvrir
La Choucroute d Alsace comme vous ne l avez jamais goûtée Dossier de presse Création graphique : Musiconair Pendant 9 jours, les Chefs d Alsace et les Maîtres Restaurateurs d Alsace vous font découvrir
Méthodes de la gestion indicielle
 Méthodes de la gestion indicielle La gestion répliquante : Ce type de gestion indicielle peut être mis en œuvre par trois manières, soit par une réplication pure, une réplication synthétique, ou une réplication
Méthodes de la gestion indicielle La gestion répliquante : Ce type de gestion indicielle peut être mis en œuvre par trois manières, soit par une réplication pure, une réplication synthétique, ou une réplication
Stratégie commerciale
 Stratégie commerciale Plan Le groupe Ferrero Présentation du produit Le marché de la pâte à tartiner Segmentation Cible Positionnement Marketing Mix : les 4P Conclusion Historique Ferrero 1946 : élaboration
Stratégie commerciale Plan Le groupe Ferrero Présentation du produit Le marché de la pâte à tartiner Segmentation Cible Positionnement Marketing Mix : les 4P Conclusion Historique Ferrero 1946 : élaboration
Recommandation sur les communications à caractère publicitaire des contrats d assurance vie
 Recommandation sur les communications à caractère publicitaire des contrats d assurance vie 2015-R-01 du 12 février 2015 1. Contexte Les communications constituent la toute première étape de la relation
Recommandation sur les communications à caractère publicitaire des contrats d assurance vie 2015-R-01 du 12 février 2015 1. Contexte Les communications constituent la toute première étape de la relation
NESPRESSO ÉTUDE DE CAS
 NESPRESSO ÉTUDE DE CAS PROBLÉMATIQUE «Comment transformer un produit usuel, le café, en un produit haut de gamme?» PLAN Introduction I Nespresso, une filiale de NESTLÉ au concept novateur II NESPRESSO,
NESPRESSO ÉTUDE DE CAS PROBLÉMATIQUE «Comment transformer un produit usuel, le café, en un produit haut de gamme?» PLAN Introduction I Nespresso, une filiale de NESTLÉ au concept novateur II NESPRESSO,
SOMMAIRE. AVRIL 2013 TECHNOLOGIE ÉTUDE POINTS DE VUE BDC Recherche et intelligence de marché de BDC TABLE DES MATIÈRES
 AVRIL 2013 TECHNOLOGIE ÉTUDE POINTS DE VUE BDC Recherche et intelligence de marché de BDC TABLE DES MATIÈRES Faits saillants du sondage 2 Contexte et méthode de sondage 3 Profil des répondants 3 Investissements
AVRIL 2013 TECHNOLOGIE ÉTUDE POINTS DE VUE BDC Recherche et intelligence de marché de BDC TABLE DES MATIÈRES Faits saillants du sondage 2 Contexte et méthode de sondage 3 Profil des répondants 3 Investissements
Note d actualité : Analyse de la loi de finances 2013
 Note d actualité : Analyse de la loi de finances 2013 Les premières mesures gouvernementales en matière d imposition des revenus (IR) et d impôt de solidarité sur la fortune (ISF) sont désormais connues.
Note d actualité : Analyse de la loi de finances 2013 Les premières mesures gouvernementales en matière d imposition des revenus (IR) et d impôt de solidarité sur la fortune (ISF) sont désormais connues.
Comptabilité à base d activités (ABC) et activités informatiques : une contribution à l amélioration des processus informatiques d une banque
 Comptabilité à base d activités (ABC) et activités informatiques : une contribution à l amélioration des processus informatiques d une banque Grégory Wegmann, Stephen Nozile To cite this version: Grégory
Comptabilité à base d activités (ABC) et activités informatiques : une contribution à l amélioration des processus informatiques d une banque Grégory Wegmann, Stephen Nozile To cite this version: Grégory
Notes de lecture : Dan SPERBER & Deirdre WILSON, La pertinence
 Notes de lecture : Dan SPERBER & Deirdre WILSON, La pertinence Gwenole Fortin To cite this version: Gwenole Fortin. Notes de lecture : Dan SPERBER & Deirdre WILSON, La pertinence. 2006.
Notes de lecture : Dan SPERBER & Deirdre WILSON, La pertinence Gwenole Fortin To cite this version: Gwenole Fortin. Notes de lecture : Dan SPERBER & Deirdre WILSON, La pertinence. 2006.
